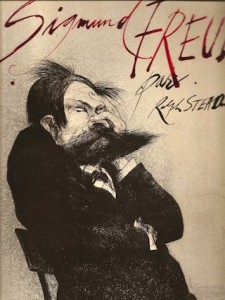pour entrer chez les Schroffenstein

Œuvre d'Erwin C. Klinzer
Le 10 juillet 1801, Heinrich von Kleist (à 24 ans) arrive à Paris, il y annonce sa tragédie : Die Familie Schroffenstein. Il l’écrira à Berne, entouré de jeunes poètes : Heinrich Zschokke, Heinrich Gessner — l’éditeur Suisse, et Louis Wieland. C’est à eux qu’il fait la lecture de son drame, il obtient un succès inattendu : cette accumulation de malentendus les plus horribles, de hasards, de quiproquos les fait « pouffer de rire ». Joachim Maass rapporte :
« On pouffait de rire, on s’exclafait, si bien que le poète lui-même, qui riait aussi, ne put continuer à lire et dut s’arrêter — ce qui, évidemment, ne voulait nullement signifier que l’œuvre n’avait pas plu. Bien au contraire : Gessner se proposa aussitôt de la publier, ce qui advint effectivement.» (Joachim Maass. « Kleist-Die Geschichte seines Lebens ». Scherz Verlag, Bern und München, 1977, Seite 61).
Avec cette œuvre inaugurale, Kleist est reconnu comme un excellent écrivain, en témoigne un article paru dans Der Freimüthige, la revue de Kotzebue :
“Der Freimüthige a aujourd’hui une bonne nouvelle à faire connaître, — il a à annoncer l’apparition d’un nouveau poète, encore inconnu, mais qui est, en vérité, un poète. » (Ludwig Ferdinand Huber, le 4 mars 1803)
Dans cette première pièce de Kleist — écrite dans une Europe bouleversée — tout y est : les soupçons — cette maladie noire de l’âme, les rumeurs, les haines entretenues, les pulsions de mort, ce que René Girard appelle « les emballements mimétiques », cette résignation nihiliste devant la fatalité (imaginée) de la catastrophe à la fois honnie et désirée, ces fantasmes de détruire l’autre et d’être détruit par l’autre. Sylvestre dit :
« Das Misstraun ist die schwarze Sucht der Seele,
Und alles, auch das Schuldlos-Reine, zieht
Fürs kranke Aug’ die Tracht der Hölle an. »
L’antithèse « Sein »-« Schein » est un des trois thèmes inhérents à la crise kantienne de Kleist : le monde des apparences ne révèle rien sur l’être. Chacune des œuvres de Kleist apportera une variation sur ce thème : où est la réalité parmi toutes les apparences dont se compose notre vie ? Comment s’orienter dans cette vie avec le sentiments pour seul guide ? Dans La famille Schroffenstein, deux faits : la noyade du jeune fils de Rupert (celui-ci s’est réellement noyé) est interprétée comme un crime commis par deux serviteurs de la branche Warwand ; la tentative de suicide de Johann, le fils naturel du même Rupert, qui n’est rien qu’amoureux d’Agnès, devient une tentative d’assassinat perpétrée sur la personne de l’unique héritière des Warwand : le « Schein » submerge le « Sein ».
Kleist qui, dans sa vie personnelle, se donne pour victime d’une force à la fois nommée destin, fatalité, hasard (Cf. Correspondance) distribue les personnages de son théâtre en êtres de raison et êtres de sentiments. À Rossitz vivent côte à côte Rupert (être de raison) et Eustache (être de sentiment) ; à Warwand, Sylvester (être de sentiment) et Gertrud (être de raison).
La dernière scène de la tragédie qui, du point de vue de sa genèse, en est le noyau ( H. von Kleist Lebensspuren. Hrsg. H. Sembdner. Bremen 1957, p. 42) a pour objet la transformation en l’autre. Cette scène donne forme aux deux thèmes fondamentaux de toute l’œuvre de Kleist dans ce qu’elle a de tragique : d’une part ce qui est facteur de séparation entre les hommes, d’autre part la difficulté de la connaissance :
« Quand tu es devant moi et que tu me regardes, que sais-tu des souffrances qui sont en moi et que sais-je des tiennes ? Et quand je me jetterais à tes pieds en pleurant et en te parlant, saurais-tu plus de choses de moi que de l’enfer, quand quelqu’un te raconte qu’il est chaud et terrible ? Ne serait-ce que pour cela, nous devrions nous autres hommes nous tenir les uns devant les autres avec autant de respect, autant de gravité et d’amour que devant les portes de l’enfer… ». (Kafka cité par Marthe Robert en 1970, dans « La traversée littéraire », p. 138, ed. Grasset).
Une dernière clé serait — afin qu’on ne se méprenne pas — la signification métaphysique du drame kleistien : il n’y a ni dieu, ni diable, ni bien, ni mal. Dans la Correspondance de Kleist transparaît son indifférence envers les doctrines religieuses. On trouve pourtant un événement, noté lors de son voyage à Paris (1801). Passant par Dresde, il assiste à la célébration d’une messe dans la cathédrale catholique (il est protestant), et est bouleversé par un service religieux qu’il trouve esthétique. La Famille Schroffenstein qu’il écrit à ce moment-là s’en trouve impressionnée et regorge de terminologie chrétienne : cf. acte I, scène 1 ; et aussi Acte III, sc 1, vers 1254-1258.
&&&
“Ce que Kleist est capable de déchaîner, ce qui jaillit, tel un éclair, dans ses lettres, dans ses nouvelles et dans ses œuvres dramatiques, nous semble être plus qu’un reflet de langage, plus qu’une saisie de la réalité même. Son langage est la trace d’une autre activité, d’un monde nouveau, jusque-là inexistant, dont les forces productives étincellent, indomptées, en tant qu’éclair ou comme une tension à laquelle il soumet la forme littéraire, pour finalement la dépasser.”
Lorsque je lis cette phrase de Mathieu Carrière, j’ai envie de la dédier aux acteurs de l’École régionale de Cannes qui ont donné — de la manière la plus brillante — La famille Schroffenstein au Festival d’Avignon cet été, mis en scène qu’ils étaient par Giorgio Barberio Corsetti. Il faut dire qu’ils avaient l’âge de Kleist quand il a écrit sa pièce !
Michèle Jung, Avignon, 2014