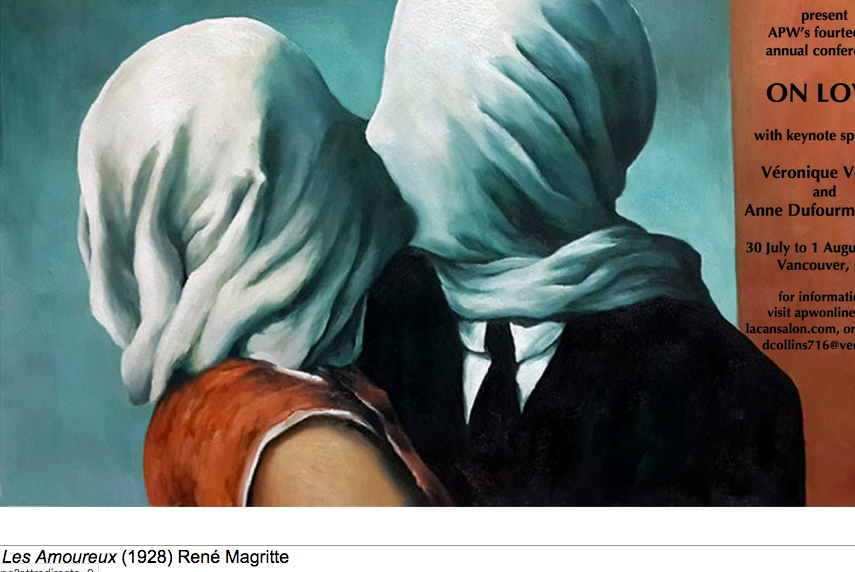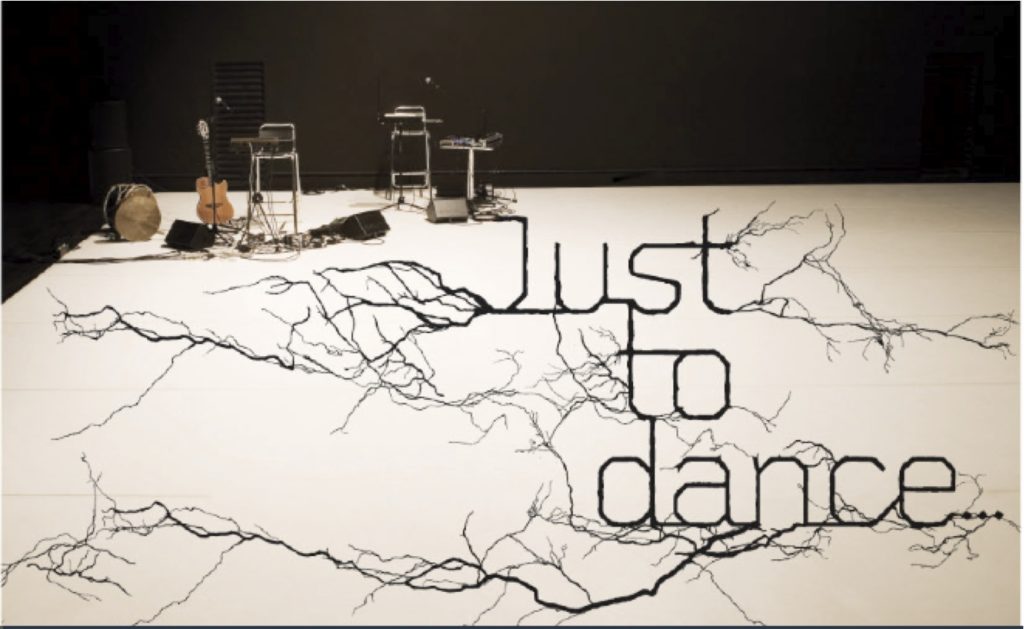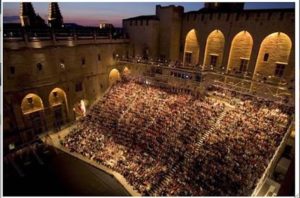Phantastische Konstruktionen der Einmauerung und des Ausgeschlossenseins. Ein öffentliches Seminar der Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin. Leitung: Claus-Dieter Rath
Samstag 13. Februar 2021 (17.15h – 19h):
Negationismus, Verwerfung und psychotischer Negativismus
Auch dieses Mal bezieht sich das Seminarthema „Lust an der Grenze“ auf individuelle und kollektive Dimensionen des Wissens und des Nichtwissenwollens.
Verwerfung nennt Freud drei verschiedene Formen der Ausgrenzung bzw. der Nicht-Annahme. Die erste davon, die uns diesmal interessiert, kommt ohne eine kritische Urteilsfindung reflexhaft zur Abweisung eines behaupteten unerträglichen Sachverhalts. Dieser wird als inexistent und seine Behauptung zu einer niederträchtigen Lüge bzw. zum Inhalt einer Verschwörung erklärt. Diese Form der Verwerfung kann Vernichtungswünsche aktivieren, etwa in Gestalt von Vorbereitungen auf einen „Tag X“ des großen Reinemachens.
Das Wort Negationismus, das bislang für die Leugnung eines Völkermords, besonders des organisierten Mordes an den Juden im Nationalsozialismus, reserviert war, wird nun auch im Zusammenhang mit der Leugnung der COVID-19 Virus-Pandemie gebraucht.
Können die Entstehung und die Wirkungen dieser gemeinhin als „irr, verrückt, hirnverbrannt“ bezeichneten Äußerungen durch klinisch-theoretische Konzepte der Psychoanalyse wie Verneinung, Verwerfung und Negativismus erhellt werden?
Und steckt in neurotischen und psychotischen Konfigurationen der Verwerfung etwas „Virales“, das sogar stabilere Massenbildungen herstellen kann?
Einleitung C.-D. Rath
„Die Bejahung – als Ersatz der Vereinigung – gehört dem Eros an, die Verneinung – Nachfolge der Ausstoßung – dem Destruktionstrieb.
Die allgemeine Verneinungslust, der Negativismus mancher Psychotiker ist wahrscheinlich als Anzeichen der Triebentmischung durch Abzug der libidinösen Komponenten zu verstehen.“ (S. Freud [1925h]. Die Verneinung. GW 14, S. 15; SA 3, S. 376.)
„Verwerfung hat bei Freud drei Valenzen: 1. als Vorstufe der Verdrängung, d.h. als forclusion im Lacan’schen Sinn, 2. als die Verdrängung selbst, 3. als ein neuer, ökonomisch besserer Mechanismus, der die Verdrängung ablöst (als Fortschritt), eine Verwerfung, die nicht auf einem Automatismus beruht, sondern auf einem Urteil. Es gibt Verwerfung also mit und Verwerfung ohne Urteil.“
(C.-D. Rath [2013]: Die »neuerliche Prüfung« als Ziel der Konstruktionen in der Analyse. Drei Arten der Verwerfung bei Freud. In: „Berliner Brief“ [Hrg. Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin], Sonderheft VII « Was in der psychoanalytischen Kur wirkt », S. 185-210.)
Peter Müller (Karlsruhe): Negativismus, Verneinung, Verwerfung
« Wo ist der Vater da drin? Er ist im Ring, der alles zusammenhält.“ (Jacques Lacan : Die Psychosen, Seminar III ; s.u., S. 376, frz. S. 359)
Zur Lektüre empfohlen:
– S. Freud (1896): Analyse eines Falles von chronischer Paranoia [Frau P.] (=Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen, Kap. III). GW I, S. 392-403.
– S. Freud: Briefe an Wilhelm Fließ 1887-1904. Frankfurt a.M.: S. Fischer. Brief 112 v. 6. Dez. 1896, S. 217-226.
– J. Lacan: Die Psychosen, Seminar III, Vorlesung XI v. 15. 2. 1956 („Über die Verwerfung eines ursprünglichen Signifikanten“); Abschnitt 3, S. 181-187, bezogen auf den obigen 112. Brief Freuds an W. Fließ (= Brief 52 in der alten Ausgabe).
Barbara Marte (Portici/Napoli): Anmerkungen zum Negativen bei Hegel, Freud und Heidegger