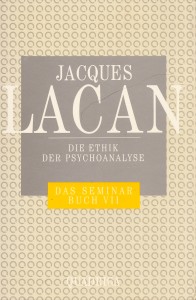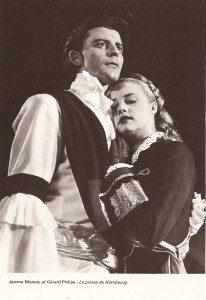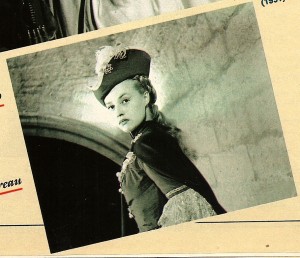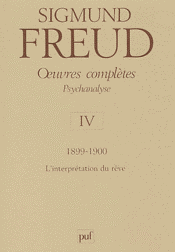Übersetzen … Freud übersetzen… Lacan übersetzen
(Der Umgang mit der deutschen Sprache ist unumgänglich)
Acheter la version allemande du Séminaire VII
Die Psychoanalyse ist mit dem Schreiben, also der Literatur verbunden. Dies ist der Grund, weshalb wir uns in diesem Jahr vorwiegend literarischen Texten zuwenden.
Weder Freud noch Lacan werden daran Anstoss nehmen. Beide haben – um ihre Theorie zu “übersetzen” – grossen Wert auf ihren literarischen Stil gelegt. Ihr Verhältnis zur Schrift ist untrennbar von ihrem Verhältnis zur Sprache und ihrer analytischen Praxis.
Freud übersetzen (ins Französische)… Lacan übersetzen (ins Deutsche)… Ironie des Schicksals, es war Lacan, der die Rückkehr zu Freud und die wörtliche Interpretation seiner Schriften anbahnte…
Dieses Seminar findet jeden dritten Montag im Monat
bei Michèle Jung in Avignon (Frankreich) statt
Erste Sitzung am Montag, 24. Januar 2011 um 20 Uhr
Kontakt : Michèle Jung
06 82 57 36 68
6 Arbeitssitzungen / Januar – Juni
Zusammenfassung
Was Freud schreibt ist das, was er sagen will. Für ihn wie auch für Peter Handke “ist die Sprache genau das, was sie ausdrückt”. Wie schrieb also Freud, wenn sein Werk in französischen Übersetzungen so problematisch ist, soviel Kritik und Streit hervorruft?
Freud war selbst Übersetzer. Für ihn hiess übersetzen interpretieren. Hier die Jones’sche Beschreibung, wie Freud im Jahre 1879 ein Buch von Stuart Mill übersetzte: Anstatt die Eigentümlichkeiten der fremden Sprache peinlich genau zu reproduzieren, las er eine Stelle, schloss das Buch und dachte darüber nach, wie ein deutscher Schriftsteller dieselben Gedanken ausgedrückt hätte. Es liegt ihm nichts an einer wortgetreuen Wiedergabe, er möchte seinem Leser nur dieselbe Wirkung vermitteln, den der Originaltext auf ihn ausgeübt hat.
Die in Freud’s Texten erkennbaren Stilfiguren erinnern mich an die Kleist’sche Schreibweise mit der ich mich in meiner Doktorarbeit intensiv beschäftigt habe. Die Freud’sche Syntax ist durch parataxische Formen unterbaut. Die Parataxe ist der Platz, der den Wörtern in einem Satz oder einer Reihe von Sätzen zugeordnet ist, unabhängig der durch Präpositionen, Konjunktionen, Deklinationen und Konjugationen gegebenen Bindungen, die für die Syntax erforderlich sind. So verliert die Schreibweise Freud’s ihre Ausdruckskraft, ja sogar ihren ganzen Sinn in der Mehrzahl der französischen Übersetzungen, da sie meistens nur den Globalsinn eines durch seine Syntax definierten Satzes wiedergeben, ohne dem Platz der Wörter und ihrer Wiederholungen die ihnen zukommende Bedeutung beizumessen.
In der Art und Weise wie Freud schrieb, hat er den Stil der Analyse geschaffen: ein Weg, ein Umweg, ein Weg ohne Ende. Ein Stil, der in einer gewissen Beziehung zum Unbewussten steht und von einem Zeitpunkt in der Kultur gekennzeichnet ist. Welche Sprache spricht das Unbewusste, könnte man fragen.
Eine wörtliche Übersetzung ist wie ein toter Buchstabe… schrieb Jacques Hassoun in L’exil de la langue. Ich habe deutschsprachige Patienten, die ihre Analyse auf Deutsch machen wollen. Ich muss also darüber nachdenken, in welcher Beziehung das Subjekt zu seiner Muttersprache steht…, mich für die Übergänge der Sprache interessieren: dies wird das Thema unseres nächsten Seminars sein.