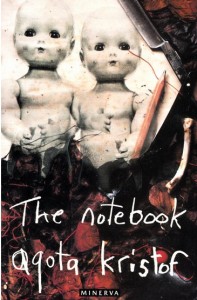Il Delirio amoroso im Juni… in Berlin
Zad Moultaka (ein libanesischer Komponist und Künstler) hat für die Deutsche Oper Berlin Delirio Komponiert, die Überschreibung eines Händel-Werkes. Die Uhraufführung, wo ich bin, ist an diesem 4. Juni.
Was passiert, wenn der Geliebte oder die Geliebte von einem Tag auf den anderen einfach verschwindet ? Wenn nichts zurückbleibt, wenn eine Existenz einfach ausgelöscht scheint ? Man sucht nach den Gründen, bei sich selbst, bei der Gesellschaft, beim Verschwundenen…
Hier, die Verlassene Clori steigt in die Unterwelt hinab, um ihrem Geliebten ins Elysium zu führen…
Georg Friedrich Haendels 1707 entstandene Solokantate streift genau diese Frage : Tirso ist gestorben und Clori steigt in den Hades hinab, um ihren Geliebten Tirso zu retten. Doch ihre Lienbe scheint nur ein Phantasma zu sein, er schaut sie noch nicht einmal an – trotzdem führt sie ihn auf die elysischen Felder. Mit abwechslungsreichen Orchesterfarben zeichnet Haendel hier das Psychogramm einer verlassenen Frau, das aber mehr ist als nur das Abziehbild der Einsam-Wahnsinnigen.
Ausgehend von Haendels Kantate hat die libanesisch-kanadische autorin Hyam Yared den Faden weitergesponnen. Durchzogen von mythologischen Anspielungen begegnet uns Clori auf der Suche nach ihrem Geliebten. Hat Tirso Clori vielleicht einfach verlassen? Ist er gestorben? Wurde er entführt ? Hyams Text setzt an dem Moment der Höllenfahrt ein. Clori begegnet einem Fährmann und einem Küstenwachmann, die ihr versichern, dass es keinen Tirso gibt oder gab. Sie bewachen nur die Weite des Meeres. Die Hölle nach der Clori sucht, sei nur eine Illusion. Eine dritte Partie, das Echo, konterkariert ihre Texte. Tirso und Tyr(os), die libanesische Hafenstadt, verschwimmen zu einem Heimatbegriff. Clori spürt noch die Spuren seiner Liebe in ihrem Leben, ihrem Körper, ihrer Stimme. Das Stück endet mit den Worten des Echos: « Seid ihr sicher, dass ihr jemals geliebt habt?»
Der Komponist Zad Moultaka nimmt Haendels Musik als Absprungpunkt für seine Imagination eine Höllenfahrt. Das kammermusikalisch besetzte Barockorchester mit Streichern, Cembalo, Blockflöte und Oboe wird durch Schlagzeug und elektronische Zuspiel erweitert.
Was bleibt von Händels Musik übrig?
Wir beginnen mit der Ouvertüre und ersten Arie von Händel und steigern uns dann immer weiter. Aber Händel bleibt die ganze Zeit als Folie anwesend. Wir haben mit dem Orchester und der Sopranistin Flurina Stucki die Kantate vorab komplett aufgenommen und ich habe daraus eine zweite musikalische Ebene gebaut – nachdem wir mit dem Händel beginnen, bleiben von ihm Reste übrig: einerseits in meiner Neukomposition, andererseits in einem Surround-Zuspiel. Händel ist so etwas wie der „happy place“, die Heimat, ein vermeintliches Idyll, das Clori immer wieder heraufbeschwören möchte.
« Ich höre Musik auch in Farben, sagt Zad Moultaka. Delirio ist für mich ein Blau, das ins Weiße geht, fast Silber. So wie das Licht des Vollmondes auf dem nächtlichen Meer. Kalt, mit einer innigen Wärme in der Atmosphäre. Ich versuche nicht, meine bildende Kunst und meine Musik miteinander zu verbinden ».